« 3:1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
3:2 La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
3:3 Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
3:4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point;
3:5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
3:6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.
3:7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.
3:8 Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
3:9 Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit: Où es-tu?
3:10 Il répondit: J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché.
3:11 Et l’Eternel Dieu dit: Qui t’a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger?
3:12 L’homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé.
3:13 Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé.
3:14 L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
3:15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
3:16 Il dit à la femme: J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
3:17 Il dit à l’homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre: Tu n’en mangeras point! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
3:18 il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs.
3:19 C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. »
La Bible – Livre de la Genèse
Ainsi, ce mythe de la Genèse qui constitue sans doute la fondation la plus solide de notre conception du travail nous indique t-il sans ambiguïté quelle est la nature de ce concept : une punition. Si l’homme n’avait pas péché, il ne travaillerait pas. Si la femme ne l’avait pas incité, elle ne connaîtrait pas les douleurs de l’enfantement, elles mêmes appelées « travail » dans les maternités. Le travail est le symptôme principal de la chute de l’homme hors du paradis originel. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si on retrouve dans toutes les cultures des équivalents de ce mythe : Eldorado, Age d’or, Jardin d’Eden participent à ce récit des origines du travail comme malheur fondateur de la déchéance humaine. Il est dès lors peu étonnant que notre relation spontanée au travail soit potentiellement conflictuelle : nous le vivons comme une obligation, une corvée, ou pour utiliser un équivalent du mot « travail », comme une peine. On sait d’ailleurs à quel point la technique, à partir du XVIIème siècle va s’évertuer à faire retrouver à l’homme un paradis qu’il pensait avoir perdu, en le libérant du travail grâce aux machines. Le rêve de l’humanité semblerait donc bien de se libérer de ce bagne, dans lequel elle est condamnée aux travaux, forcée par sa situation et par la nature même du monde à souffrir pour obtenir ne serait-ce que le minimum vital.
On est obligé de travailler si on veut acquérir de manière honnête la moindre chose. Mais on pourrait rêver que le bonheur soit ailleurs : dans une situation où le travail ne serait pas nécessaire. Il nous semble même évident que si on devait établir le cahier des charges du bonheur, le travail n’en ferait pas partie.
Pourtant, vouloir donner comme idéal à l’humanité une situation qui relève du mythe n’est pas sans dangers. Car le mythe explique une situation réelle mais insatisfaisante (le travail obligatoire) en la confrontant à une autre situation, idyllique, mais fictive (le paradis, l’eldorado…). N’est ce pas là donner de faux espoirs à l’homme ? Poser la question du rapport nécessaire entre travail et bonheur, c’est donc finalement se demander quelle image de l’homme est la bonne : celle d’une créature pouvant revendiquer un droit à la pure jouissance, ou celle d’un être qui n’obtient rien sans rien, et qui doit donc en passer par le travail pour obtenir ce qu’il désire, irrémédiablement.
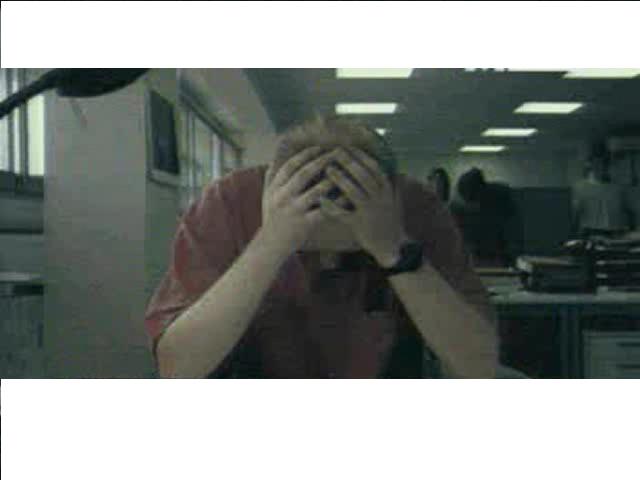
Est-ce un rêve nouveau ? C’est douteux. Ce qui est nouveau, c’est que l’homme se découvre les moyens de parvenir à ce rêve, ce qui avant le XVIIème siècle n’était pas le cas. Mais si on cherche dans la Grèce antique ce qu’on peut en penser, on découvre qu’Aristote par exemple, regrette que l’homme ait à travailler pour obtenir ce qu’il désire ou même ce dont il a besoin. Et devant ce constat, il reconnaît qu’il faut bien que l’humanité se débrouille avec les moyens qui sont les siens :
« les instruments sont soit inanimés soit animés, par exemple pour le pilote le gouvernail est un instrument inanimé alors que le timonier est un instrument animé (car l’exécutant dans les différents métiers entre dans la catégorie de l’instrument) ; de même aussi un bien que l’on a acquis est un instrument pour vivre, la propriété familiale est une masse d’instruments, l’esclave est un bien acquis animé et tout exécutant est un instrument antérieur aux instruments qu’il met en œuvre. Si donc il était possible à chaque instrument parce qu’il en aurait reçu l’ordre ou par simple pressentiment de mener à bien son œuvre propre, comme on le dit des statues de Dédale ou des trépieds d’Héphaïstos qui, selon le poète, entraient d’eux-mêmes dans l’assemblée des dieux, si, de même, les navettes tissaient d’elles-mêmes et les plectres jouaient tout seuls de la cithare, alors les ingénieurs n’auraient pas besoin d’exécutants ni les maîtres d’esclaves. »
Aristote, Politique, I, 4, 1253b-1254a
Ce texte peut paraître aujourd’hui bien barbare, dans la mesure où il semble justifier l’esclavage. Il énonce pourtant une évidence : si on pouvait obtenir directement ce qu’on désire, on se passerait de travailler. D’ailleurs, l’esclavage n’a ici pas d’autre but que de combler cette lacune humaine : comme on ne peut obtenir directement ce qu’on veut, on fait en sorte que d’autres nous le procurent, en fournissant eux-mêmes l’effort nécessaire. On peut se scandaliser à bon compte sur le texte d’Aristote, mais il ne décrit finalement rien de plus barbare que la condition ouvrière telle qu’elle sera inventée par le monde occidental plus tard dans l’histoire, nous y reviendrons. Aristote, comme Descartes cherche donc à permettre à l’homme d’échapper au travail, il le fait avec des moyens autres, mais l’objectif est déjà le même. Est-ce une position isolée ? Les autres grecs sont ils plus désireux de travailler ? On peut en douter. Voici le tableau que dresse Paul Lafargue, en 1883, dans un livre intitulé Le droit à la paresse :

» Je ne saurais affirmer, dit le père de l’histoire, Hérodote, si les Grecs tiennent des Égyptiens le mépris qu’ils font du travail, parce que je trouve le même mépris établi parmi les Thraces, les Scythes, les Perses, les Lydiens; en un mot parce que chez la plupart des barbares, ceux qui apprennent les arts mécaniques et même leurs enfants sont regardés comme les derniers des citoyens… Tous les Grecs ont été élevés dans ces principes, particulièrement les Lacédémoniens (23). »
« À Athènes, les citoyens étaient de véritables nobles qui ne devaient s’occuper que de la défense et de l’administration de la communauté, comme les guerriers sauvages dont ils tiraient leur origine. Devant donc être libres de tout leur temps pour veiller, par leur force intellectuelle et corporelle, aux intérêts de la République, ils chargeaient les esclaves de tout travail. De même à Lacédémone, les femmes mêmes ne devaient ni filer ni tisser pour ne pas déroger à leur noblesse (24). »
Les Romains ne connaissaient que deux métiers nobles et libres, l’agriculture et les armes; tous les citoyens vivaient de droit aux dépens du Trésor, sans pouvoir être contraints de pourvoir à leur subsistance par aucun des « sordidoe artes » (ils désignaient ainsi les métiers) qui appartenaient de droit aux esclaves. Brutus, l’ancien, pour soulever le peuple, accusa surtout Tarquin, le tyran, d’avoir fait des artisans et des maçons avec des citoyens libres (25).
Les philosophes anciens se disputaient sur l’origine des idées, mais ils tombaient d’accord s’il s’agissait d’abhorrer le travail.
« La nature, dit Platon, dans son utopie sociale, dans sa « République » modèle, la nature n’a fait ni cordonnier, ni forgeron; de pareilles occupations dégradent les gens qui les exercent, vils mercenaires, misérables sans nom qui sont exclus par leur état même des droits politiques. Quant aux marchands accoutumés à mentir et à tromper, on ne les souffrira dans la cité que comme un mal nécessaire. Le citoyen qui se sera avili par le commerce de boutique sera poursuivi pour ce délit. S’il est convaincu, il sera condamné à un an de prison. La punition sera double à chaque récidive (26). »
Dans son « Économique », Xénophon écrit:
« Les gens qui se livrent aux travaux manuels ne sont jamais élevés aux charges, et on a bien raison. La plupart, condamnés à être assis tout le jour, quelques-uns même à éprouver un feu continuel, ne peuvent manquer d’avoir le corps altéré et il est bien difficile que l’esprit ne s’en ressente. »
« Que peut-il sortir d’honorable d’une boutique ? professe Cicéron, et qu’est-ce que le commerce peut produire d’honnête ? Tout ce qui s’appelle boutique est indigne d’un honnête homme […], les marchands ne pouvant gagner sans mentir, et quoi de plus honteux que le mensonge ! Donc, on doit regarder comme quelque chose de bas et de vil le métier de tous ceux qui vendent leur peine et leur industrie; car quiconque donne son travail pour de l’argent se vend lui-même et se met au rang des esclaves (27). »
Prolétaires, abrutis par le dogme du travail, entendez-vous le langage de ces philosophes, que l’on vous cache avec un soin jaloux: un citoyen qui donne son travail pour de l’argent se dégrade au rang des esclaves, il commet un crime, qui mérite des années de prison. La tartuferie chrétienne et l’utilitarisme capitaliste n’avaient pas perverti ces philosophes des Républiques antiques; professant pour des hommes libres, ils parlaient naïvement leur pensée. Platon, Aristote, ces penseurs géants, dont nos Cousin, nos Caro, nos Simon ne peuvent atteindre la cheville qu’en se haussant sur la pointe des pieds, voulaient que les citoyens de leurs Républiques idéales vécussent dans le plus grand loisir, car, ajoutait Xénophon, « le travail emporte tout le temps et avec lui on n’a nul loisir pour la République et les amis ». Selon Plutarque, le grand titre de Lycurgue, « le plus sage des hommes » à l’admiration de la postérité, était d’avoir accordé des loisirs aux citoyens de la République en leur interdisant un métier quelconque (28).
23 – Hérodote, t. ll, trad. Larcher, 1876.
24 – Biot, « De l’abolition de l’esclavage ancien en Occident », 1840.
25 – Tite-Live, livre premier.
26 – Platon, « République », livre V.
27 – Cicéron, « Des devoirs », I, tit. ll, chap. XLII.
28 – Platon, « République », V, et les « Lois », III; Aristote, « Politique », II et VII; Xénophon, « Economique », IV et VI; Plutarque, « Vie de Lycurgue ».
Peut on être plus clair sur ce rejet global du travail ? Manifestement, qu’il s’agisse des temps pré philosophiques, avec les mythes racontant la chute de l’homme dans cette pénible activité qu’est le travail, qu’on se réfère aux philosophes antiques ou à celui qui va ouvrir la voie de la modernité, on retrouve cette même réticence envers le travail, cet espoir qu’on trouve un moyen pour nous en affranchir.
Pour autant, on ne peut ignorer certains aspects de ce rêve : on l’a vu, le bonheur, qu’on le place dans l’Eldorado, le jardin d’Eden, ou l’âge d’or, est systématiquement placé dans le domaine de l’utopie. Etymologiquement, l’utopie vient du grec «topos» qui signifie «lieu». Le «u» signale la notion d’amputation, d’absence. L’utopie est donc un non lieu, un lieu qui n’a pas d’existence autre que celle de l’imagination. Cela signifie t-il que les pensées qui se réfèrent à de telles utopies placent le bonheur comme définitivement inaccessible ? Si tel était le cas, alors on pourrait se demander quelle valeur devrait avoir notre préférence, entre celle du travail, dont les apports sont concrets, tangibles malgré sa pénibilité, et celle du bonheur dont on imagine les bienfaits, mais dont on peine justement à dépasser sa simple imagination.
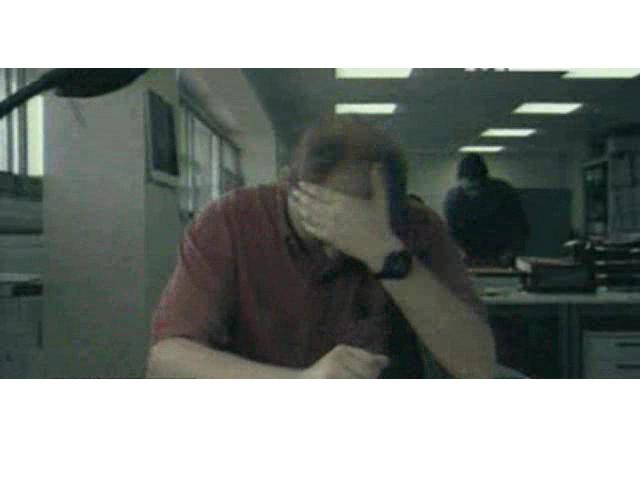
Cependant, il semble simplificateur de n’envisager le travail que sous l’angle de la fatigue qu’il procure. Travailler ne consiste pas à dépenser de manière inconsidérée son énergie. Le principe du travail est que cette énergie soit dirigée, contrôlée, orientée dans un but précis. Et pour que ce soit le cas, il est nécessaire que ce but soit précisé AVANT que le travail ait lieu. On distinguera donc deux phases dans le travail : un premier temps de conception, et un second temps de réalisation. Or, si les grecs en particulier répugnaient à travailler, c’est parce qu’ils donnaient la préférence à l’activité intellectuelle, à l’esprit, et que le travail ne désignait pour eux que la partie matérielle de la transformation du monde. Tout leur système social tendait à tenir les citoyens éloignés des implications trop matérielles dans le monde, aussi bien en matière de transformation de celui-ci (ils refusent les activités manuelles) qu’en matière de reproduction (pour eux, l’homosexualité est une forme plus élevée de sexualité puisqu’elle est moins impliquée dans la réalité matérielle du monde). Refuser de travailler, c’est donc s’affirmer comme étant « au dessus de tout », au-delà des réalités matérielles, se rendre plus spirituel en somme.
Mais leur conception du travail est en fait incomplète nous le voyons maintenant. Réduire le travail à la dépense d’énergie, à la fatigue et au fait de se frotter à la matière, en faire une activité uniquement matérielle, c’est oublier qu’avant les mains, c’est bien l’esprit qui est à l’œuvre dans le travail. Les mains ne font qu’accomplir, l’esprit les dirige. Transformer le monde, pour l’homme consiste d’abord à le penser, à s’en faire une représentation, mais aussi à concevoir ce que ce monde pourrait être. Un colon européen en Amérique du Nord ne s’installe quelque part que parce qu’il imagine à l’avance ce que deviendra le lieu qu’il a choisi quand il l’aura transformé. Ce travail commence donc bien avec une phase de conception, qu’on pourrait appeler « spirituelle », même si ensuite il s’agira bien de composer avec la matière, son poids, ses difficultés, la résistance qu’elle présentera.
Ce qu’on peut conclure de ceci, c’est que si la raison véritable de refuser le travail, c’est le fait que cette activité est trop matérielle, alors on a ici vu que cette raison est mauvaise, le travail étant par définition spirituel. En réalité, ce que refusent les grecs, c’est ce que nous appellerions l’accomplissement de tâches. Une tâche est un geste effectué selon des consignes bien précises, mais sans avoir à y réfléchir. Une tâche doit être exécutée, et elle peut l’être tout aussi bien par un homme ou par une machine. Si on reprend le texte d’Aristote, il est clair que c’est cela qu’il cherche à éviter à l’homme, quitte à recourir aux esclaves pour cela : le faire déchoir dans le simple accomplissement de tâches. Et lui-même, dans un autre texte, va par contre reconnaître le caractère profondément humanisant du travail, en en faisant LA caractéristique humaine par excellence :

Aristote – Les Parties des animaux, § 10, 687 b, éd. Les Belles Lettres, trad. P. Louis, pp. 136-137.
On assiste dans ce texte à une véritable réconciliation entre l’activité manuelle et celle de l’esprit : finalement, si il a des mains, et si ces mains n’ont pas d’activité spécialisée identifiée, c’est qu’elles imposent à l’homme de réfléchir à leur usage. La preuve, c’est que l’homme ne se contente pas de l’usage primitif de ses mains. Mais il les équipe d’outils. Or un outil, c’est un intermédiaire entre le monde tel qu’il est, et le monde qu’on veut obtenir. Pour créer un outil, il faut être supérieurement intelligent, concevoir ce qu’on veut obtenir et concevoir la manière dont on va l’obtenir. Ainsi pourrait on dire que l’être humain est pleinement humain justement quand il travaille. C’est ainsi que Bergson va construire au début du XXème siècle, cette idée que ce qui caractérise l’homme en premier lieu, c’est qu’il fabrique. Avant d’être un homo-sapiens, c’est un homo-faber. :
« En ce qui concerne l’intelligence humaine, on n’a pas assez remarqué que l’invention mécanique a d’abord été sa démarche essentielle, qu’aujourd’hui encore notre vie sociale gravite autour de la fabrication et de l’utilisation d’instruments artificiels, que les inventions qui jalonnent la route du progrès en ont aussi tracé la direction. Nous avons de la peine à nous en apercevoir, parce que les modifications de l’humanité retardent d’ordinaire sur les transformations de son outillage. Nos habitudes individuelles et même sociales survivent assez longtemps aux circonstances pour lesquelles elles étaient faites, de sorte que les effets profonds d’une invention se font remarquer lorsque nous en avons déjà perdu de vue la nouveauté. […] Dans des milliers d’années, quand le recul du passé n’en laissera plus apercevoir que les grandes lignes, nos guerres et nos révolutions compteront pour peu de chose, à supposer qu’on s’en souvienne encore; mais de la machine à vapeur, avec les inventions de tout genre qui lui font cortège, on parlera peut-être comme nous parlons du bronze ou de la pierre taillée; elle servira à définir un âge. Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l’histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l’homme et de l’intelligence, nous ne dirions peut-être pas Homo sapiens, mais Homo faber. En définitive, l’intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils et d’en varier indéfiniment la fabrication. »
Henri Bergson, L’Évolution créatrice (1907), Éd. PUF, coll. « Quadrige », 1996, chap. II, pp.138-140.
Comment dès lors justifier davantage le refus du travail alors qu’on voit ici que c’est au contraire l’activité qui permet d’humaniser l’homme, à tel point qu’un philosophe comme Emmanuel Mounier écrira une phrase telle que « Tout travail travaille à faire un homme en même temps qu’une chose » ? Comment mieux synthétiser notre recherche à ce point de la réflexion ? On pensait en première partie que le travail était inhumain, indigne de son statut et on voulait l’en débarrasser pour qu’il puisse aller vers le bonheur, on constate maintenant qu’il parait plus rationnel de considérer le travail comme spécifiquement humain, et ce aussi bien pour l’humanité toute entière qui se distingue du règne animal (qui lui ne fait qu’accomplir des tâches) que pour l’individu lui-même qui, grâce au travail peut imprimer la marque de son esprit sur le monde et se distinguer ainsi de ceux qui, autrement, ne seraient justement que ses semblables.
Peut on en déduire que pour être heureux il est nécessaire de travailler ? Autant on a vu que spontanément on avait répondu non à cette question, autant ici on est amené à répondre oui. Mais cela se fait au prix d’un changement radical dans la définition du concept de « travail ». On le voit, le travail permet à l’homme d’être lui-même, et si on admet que le bonheur consiste à être soi-même, alors on doit admettre que le travail rend heureux. Cependant, une telle affirmation parait bien triste : cette conception du bonheur parait bien rationnelle et aride face à l’image que les mythes donnent du bonheur tel qu’il semble être vécu dans les paradis originels.
 En effet, que vaut la lutte du travailleur face à la description que fait Voltaire de l’entrée de Pangloss dans l’Eldorado dans Candide ? Voltaire n’hésite pas et nous fournit une description de ce lieu d’abondance en forme de prospectus publicitaire pour les plus grands palaces… à ceci près que dans l’Eldorado, tout est gratuit. Et encore… les hôtes de Pangloss et de son guide s’excusent, une fois qu’ils ont mangé le plus grand repas qu’ils aient jamais connu, de ne leur proposer qu’un repas aussi pauvre, regrettant de ne pouvoir les satisfaire de manière plus abondante :
En effet, que vaut la lutte du travailleur face à la description que fait Voltaire de l’entrée de Pangloss dans l’Eldorado dans Candide ? Voltaire n’hésite pas et nous fournit une description de ce lieu d’abondance en forme de prospectus publicitaire pour les plus grands palaces… à ceci près que dans l’Eldorado, tout est gratuit. Et encore… les hôtes de Pangloss et de son guide s’excusent, une fois qu’ils ont mangé le plus grand repas qu’ils aient jamais connu, de ne leur proposer qu’un repas aussi pauvre, regrettant de ne pouvoir les satisfaire de manière plus abondante :
« Ils approchèrent enfin de la première maison du village ; elle était bâtie comme un palais d’Europe. Une foule de monde s’empressait à la porte, et encore plus dans le logis. Une musique très agréable se faisait entendre, et une odeur délicieuse de cuisine se faisait sentir. Cacambo s’approcha de la porte, et entendit qu’on parlait péruvien ; c’était sa langue maternelle : car tout le monde sait que Cacambo était né au Tucuman, dans un village où l’on ne connaissait que cette langue. « Je vous servirai d’interprète, dit-il à Candide ; entrons, c’est ici un cabaret. » Aussitôt deux garçons et deux filles de l’hôtellerie, vêtus de drap d’or, et les cheveux renoués avec des rubans, les invitent à se mettre à la table de l’hôte. On servit quatre potages garnis chacun de deux perroquets, un contour bouilli qui pesait deux cents livres, deux singes rôtis d’un goût excellent, trois cents colibris dans un plat, et six cents oiseaux-mouches dans un autre ; des ragoûts exquis, des pâtisseries délicieuses ; le tout dans des plats d’une espèce de cristal de roche. Les garçons et les filles de l’hôtellerie versaient plusieurs liqueurs faites de canne de sucre.
Les convives étaient pour la plupart des marchands et des voituriers, tous d’une politesse extrême, qui firent quelques questions à Cacambo avec la discrétion la plus circonspecte, et qui répondirent aux siennes d’une manière à le satisfaire.
Quand le repas fut fini, Cacambo crut, ainsi que Candide, bien payer son écot en jetant sur la table de l’hôte deux de ces larges pièces d’or qu’il avait ramassées ; l’hôte et l’hôtesse éclatèrent de rire, et se tinrent longtemps les côtés. Enfin ils se remirent : « Messieurs, dit l’hôte, nous voyons bien que vous êtes des étrangers ; nous ne sommes pas accoutumés à en voir. Pardonnez-nous si nous nous sommes mis à rire quand vous nous avez offert en payement les cailloux de nos grands chemins. Vous n’avez pas sans doute de la monnaie du pays, mais il n’est pas nécessaire d’en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies pour la commodité du commerce sont payées par le gouvernement. Vous avez fait mauvaise chère ici, parce que c’est un pauvre village ; mais partout ailleurs vous serez reçus comme vous méritez de l’être. » Cacambo expliquait à Candide tous les discours de l’hôte, et Candide les écoutait avec la même admiration et le même égarement que son ami Cacambo les rendait. « Quel est donc ce pays, disaient-ils l’un et l’autre, inconnu à tout le reste de la terre, et où toute la nature est d’une espèce si différente de la nôtre ? C’est probablement le pays où tout va bien ; car il faut absolument qu’il y en ait de cette espèce. Et, quoi qu’en dît maître Pangloss, je me suis souvent aperçu que tout allait assez mal en Westphalie. »
Comment, après une telle description, se faire à l’idée que le bonheur, ça n’est pas cela, mais le fait de travailler pour se procurer ce que l’on désire ? Ce qui rend l’idée décevante, c’est d’abord qu’on perd l’immédiateté de la jouissance : au paradis comme dans l’eldorado, il n’y pas de temps d’attente, on obtient tout ce qu’on désire de manière immédiate. C’est d’ailleurs l’absence de ce temps d’attente qui caractérisait la jouissance. Ensuite, et c’est la conséquence de ce qui précède, si cette nouvelle conception du bonheur est décevante, c’est qu’il n’est pas donné mais doit être acquis. Et ceci vaut pour toutes les générations de l’humanité : si chaque homme doit travailler pour être heureux, alors jamais une génération ne pourra s’appuyer sur les fruits du travail des générations précédentes pour être heureuse. Ce serait la fin de l’humanité elle-même.
On pourrait objecter que pourtant, Descartes, comme on l’a vu au début de notre réflexion promettait que la technique nous rendrait « comme maîtres et possesseurs de la nature ». Qu’en est il de cette promesse (qui était assortie d’un espoir de voir le travail disparaître) s’il apparaît que l’homme doit travailler pour être heureux ? Cette situation moderne ne décevra pourtant que ceux qui ont mal lu Descartes. Il ne promet pas de devenir véritablement maîtres et possesseurs de cette nature, mais de devenir COMME maîtres et possesseurs de la nature. Nuance importante : cette maîtrise de la nature passe par une acquisition sans cesse remise en jeu. Si ce n’était pas le cas, si à un moment donné l’humanité pouvait se dire qu’elle en est à maîtriser véritablement la nature, c’est qu’elle serait devenue autre chose que l’humanité. Seuls les animaux et Dieu peuvent se contenter de la nature telle qu’elle est. L’homme doit la travailler pour y survivre, mais aussi pour laisser de lui-même une trace qui demeure, qui témoigne de sa conscience. Mais l’image du bonheur supérieur que serait le paradis originel reste ancrée en nous, à tel point que nous plaçons encore des espoirs dans cette forme de bonheur qui, pourtant, relève bien de la fiction : jouer aux jeux comme le loto, c’est placer son bonheur du côté de l’abondance sans limites d’argent, et c’est en même temps reconnaître que cette profusion ne peut pas venir que de nôtre seul travail. La société de consommation dans son ensemble s’appuie d’ailleurs sur l’idée de l’abondance, qui est en fait un mythe : pour l’antiquité grecque, l’abondance est associée à Zeus. En effet, quand Zeus naît, il doit être caché pour échapper à son propre père, Chronos (belle image puisque ce dieu qui deviendra le plus grand des dieux, échappe en fait au temps qui dévore tout, et en particulier les hommes). Pour le sauver, sa mère confie donc Zeus enfant à une chèvre appelée Amalthée, qui le nourrira et lui donnera tant de force que Zeus lui brisera incidemment une corne. Cette corne brisée, il en fera dont aux nymphes, et elle aura comme pouvoir de fournir tout ce qui est nécessaire à la vie de manière illimitée. Le mythe dit clairement qu’échapper au temps et bénéficier sans travailler de l’abondance est le privilège des dieux et qu’il n’y aurait rien d’humain dans cette situation. Cela n’empêche pas l’homme de rêver qu’il atteigne cette condition divine, l’idéal étant de ne rien faire pour y parvenir. Le loto semble tout indiqué pour cela. Mais les gagnants, aussi rares que pouvaient l’être les élus des dieux, doivent alors se confronter au fait que se contenter de jouir n’est justement pas la définition de l’être humain, et qu’il va falloir tout de même travailler.
Belle occasion de mettre tout le monde au travail ! Peu à peu on a vu l’idéologie se renverser : on est passé d’un monde antique où la politique faisait en sorte que les citoyens n’aient pas à travailler, voire même punissait ceux qui se livraient au travail, à une société dans laquelle le travail est devenu une valeur centrale, dont on inculque les bienfaits dès l’école. Si on se contente de la réflexion que nous avons effectuée, on devrait plutôt s’en réjouir. Cependant, il faudrait vérifier alors qu’on ne se sert pas de ce type d’arguments pour les détourner de leurs buts premiers. Notre discours a consisté à dire que le travail doit permettre à l’homme de se réaliser, dans la mesure où c’est une activité spirituelle. Cela a pour conséquence logique que tout «travail » qui ne serait que l’accomplissement d’une tâche au sens où nous l’avons définie plus haut empêche l’homme de se bâtir. Or on sait que ce que nous appelons le monde du travail ne propose justement pas systématiquement du travail, au sens plein du terme. Ce monde du travail est avant tout un monde de l’emploi. Revenons une dernière fois à l’étymologie : « emploi » dérive du latin «implicare » qui signifie en premier lieu « plier, emmêler, entortiller ». Employer quelqu’un, c’est donc l’attacher à une mission, à un statut, à une fonction. Cela laisse la possibilité de ne lui faire accomplir que des tâches. On peut relire le texte d’Aristote sur l’esclavage, dont on pouvait s’offusquer, et remplacer le mot « esclave » par « main d’œuvre », ou même « ouvrier ». Le texte gardera la même logique, la même cohérence. En perd il pour autant son caractère choquant ? De nombreux auteurs l’ont étudié, et constaté : le travail, quand il n’est qu’accomplissement de tâches, est aliénant. Bergson en montre les dangers, Lafargue, dans son Droit à la paresse l’énonce clairement aussi : tout emploi n’est pas un travail, (pas plus que tout travail n’est un emploi) et comprendre notre affirmation selon laquelle il faut travailler pour être heureux comme un appel au plein emploi serait une erreur et une malhonnêteté intellectuelle. Au contraire, il apparaît que si le travail est nécessaire à une certaine forme de bonheur, certaines formes d’emploi constituent au contraire un obstacle majeur dans la recherche de ce même bonheur. La littérature elle-même a pris le relais des philosophes sur ce terrain : en 2000, l’écrivain Yves Pages publiait un livre intitulé Petites natures mortes au travail , recueil de récits courts ayant pour cadre le monde du travail. Dans le second chapitre, «Pluto que rien», on trouve une description finalement fidèle du non sens que peut atteindre l’emploi :
« Avec cette queue morte qui traîne dans mon dos, c’est dur de bien se tenir. Les mômes tirent dessus, et moi, je n’ai pas le droit de bouger pendant que leur parents prennent la photo. Toute la journée, on m’agrippe, on me tripote dans le sens du poil, on me pince jusqu’au sang (…) A force d’amour, ils en viendraient à me lyncher. Le plus pénible quand on mesure deux mètres cinquante, c’est de changer de place sans tituber bêtement. Ou de se faire un croche patte en reculant sous la pression de la foule. Si je n’avais pas ce long nez creux au milieu de la gueule, je ne serais pas obligé de loucher ou même, en douce, de regarder par le trou de ma bouche, ce qui n’est pas permis. Ni de répondre quand on m’aboie dessus » C’est un chien qui le dit, un clebs salarié s’entend.
« Ici je me tiens coi vu que, dans mon contrat de travail, je n’ai pas l’usage de la parole. Ils ont acheté mon silence, alors je signe des autographes. A Marne-la-Vallée, je suis l’un des plus connus, employé pour signer six cent fois Pluto par jour avec seulement trois doigts à chaque main ».
Sous-homme sandwich en hiver, hot-dog en été, José, chômeur réinséré à quatre pattes, touche 35 francs de l’heure à se faire valoir. « Si l’envie d’uriner me presse, je lève les deux bras au ciel. C’est un signe convenu avec les agents de sécurité pour qu’ils me retirent de la circulation. Ensuite, dans les coulisses en pré-fabriqué, un vigile m’ôte la tête caoutchoutée, le pelage synthétique, et je me dépêche aux toilettes. Quand le soleil tape trop fort l’après-midi, c’est pire qu’un sauna à l’intérieur, ça me démange tellement que je me délivrerais bien d’un coup de cutter. Heureusement, on m’autorise une pause toutes les demi-heures, sinon j’étoufferais sous le masque, et Pluto ne saurait s’évanouir devant ses fans ».
Que José perde connaissance, c’est pourtant l’effet d’illusion recherché, mais par d’autres moyens. Maintenant que les camps de travail sont ouverts au public, les comédiens domestiques doivent suer sous leur seconde peau et se taire jusqu’à faire disparaître en eux la trace obscène du labeur. L’attraction moderne a sa loi : si tu veux abolir le prolétariat, donne-le en spectacle. »
Notons que le chapitre suivant porte pour titre « Il était une fois l’aliénation », c’est assez dire combien la littérature, et donc la pensée contemporaine, ont saisi que l’emploi n’était pas par essence libérateur, malgré le salaire qui en est la contrepartie. C’est la raison pour laquelle notre réflexion ne pouvait pas faire l’économie de la distinction entre « travail » et « emploi ». C’est bien de l’emploi que les grecs et les romains essayaient de se débarrasser. C’est bien l’emploi qu’on proposa aux ouvriers quand l’heure de l’industrialisation fut venue. Et c’est bien de cette forme de travail qu’on peut craindre qu’elle ne permette pas, et de loin, à l’homme d’être heureux, alors même que c’est celle qui vient en premier à l’esprit comme moyen d’accéder au bonheur.
On pourrait craindre que la situation du travailleur soit absurde : finalement on voit qu’on travaille parce qu’on n’est pas satisfait par la vie telle qu’elle est, et que pour autant ce travail ne cessera jamais, car la mission est trop vaste, et que surtout le fruit du travail n’est jamais le dernier pas vers le bonheur accompli. Celui-ci est toujours plus loin, idéal hors d’atteinte, comme un horizon. Le sort de l’homme serait alors celui d’une insatisfaction perpétuelle, quels que soient les efforts qu’il fasse. Cette absurdité, Albert Camus en est sans doute le meilleur interprète. Dans son livre Le mythe de Sisyphe, il s’attaque précisément à cette absurdité, à travers l’image mythique de Sisyphe, condamné pour l’éternité à pousser un rocher en haut d’une pente, pour le voir systématiquement retomber en bas, et recommencer ce travail insensé ad vitam æternam, à ceci près que Sisyphe est immortel. On a vite fait de tracer un parallèle entre Sisyphe et l’homme, tous deux souffrent au travail, tous deux peinent à voir du sens derrière leur activité sans fin. Pour autant, voici comment Camus conclue son livre :

C’est pendant ce retour, cette pause, que Sisyphe m’intéresse. Un visage qui peine si près des pierres est déjà pierre lui-même. Je vois cet homme redescendre d’un pas lourd mais égal vers le tourment dont il ne connaîtra pas la fin. Cette heure qui est comme une respiration et qui revient aussi sûrement que son malheur, cette heure est celle de la conscience. A chacun de ces instants, où il quitte les sommets et s’enfonce peu à peu vers les tanières des dieux, il est supérieur à son destin. Il est plus fort que son rocher.
Si ce mythe est tragique, c’est que son héros est conscient. Où serait en effet sa peine, si à chaque pas l’espoir de réussir le soutenait ? L’ouvrier d’aujourd’hui travaille, tous les jours de sa vie, aux mêmes tâches et ce destin n’est pas moins absurde. Mais il n’est tragique qu’aux rares moments où il devient conscient. Sisyphe, prolétaire des dieux, impuissant et révolté, connaît toute l’étendue de sa misérable condition : c’est à elle qu’il pense pendant sa descente. La clairvoyance qui devait faire son tourment consomme du même coup sa victoire. Il n’est pas de destin qui ne se surmonte par le mépris.
Si la descente ainsi se fait certains jours dans la douleur, elle peut se faire aussi dans la joie. Ce mot n’est pas de trop. J’imagine encore Sisyphe revenant vers son rocher, et la douleur était au début. Quand les images de la terre tiennent trop fort au souvenir, quand l’appel du bonheur se fait trop pressant, il arrive que la tristesse se lève au cœur de l’homme : c’est la victoire du rocher, c’est le rocher lui-même. Ce sont nos nuits de Gethsémani. Mais les vérités écrasantes périssent d’être reconnues. Ainsi, Œdipe obéit d’abord au destin sans le savoir. A partir du moment où il sait, sa tragédie commence. Mais dans le même instant, aveugle et désespéré, il reconnaît que le seul lien qui le rattache au monde, c’est la main fraîche d’une jeune fille. Une parole démesurée retentit alors : » Malgré tant d’épreuves, mon âge avancé et la grandeur de mon âme me font juger que tout est bien. » L’Œdipe de Sophocle, comme le Kirilov de Dostoïevsky, donne ainsi la formule de la victoire absurde. La sagesse antique rejoint l’héroïsme moderne.
On ne découvre pas l’absurde sans être tenté d’écrire quelque manuel du bonheur. » Eh ! quoi, par des voies si étroites… ? » Mais il n’y a qu’un monde. Le bonheur et l’absurde sont deux fils de la même terre. Ils sont inséparables. L’erreur serait de dire que le bonheur naît forcément de la découverte absurde. Il arrive aussi bien que le sentiment de l’absurde naisse du bonheur. » Je juge que tout est bien « , dit Œdipe, et cette parole est sacrée. Elle retentit dans l’univers farouche et limité de l’homme. Elle enseigne que tout n’est pas, n’a pas été épuisé. Elle chasse de ce monde un dieu qui y était entré avec l’insatisfaction et le goût des douleurs inutiles. Elle fait du destin une affaire d’homme, qui doit être réglée entre les hommes.
Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. De même, l’homme absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes les idoles. Dans l’univers soudain rendu à son silence, les mille petites voix émerveillées de la terre s’élèvent. Appels inconscients et secrets, invitations de tous les visages, ils sont l’envers nécessaire et le prix de la victoire. Il n’y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit.
L’homme absurde dit oui et son effort n’aura plus de cesse. S’il y a un destin personnel, il n’y a point de destinée supérieure ou du moins il n’en est qu’une dont il juge qu’elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait le maître de ses jours. A cet instant subtil où l’homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d’actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l’origine tout humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n’a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore.
Je laisse Sisyphe au bas de la montagne ! On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni fertile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. »
Camus – Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, 1942.
Camus dresse lui-même le parallèle entre le personnage mythique et l’ouvrier confronté à son travail. Dans les deux conditions, la même absurdité. On l’a vu, la condition ouvrière, si elle consiste à n’avoir qu’un emploi, est finalement aussi peu censée que celle de Sisyphe. Mais on le voit aussi, finalement, Sisyphe souffre que son effort ne poursuive et n’atteigne aucun but. Son effort est proprement inhumain, et on ne peut s’empêcher de penser que si vraiment ce rocher doit être remonté en haut de cette pente, une machine le ferait tout aussi bien, il n’est pas nécessaire de faire accomplir cette tâche à un homme. Sisyphe est puni. Mais l’homme ne l’est pas. Relisons le texte biblique. Même lui n’indique pas une punition faite à l’homme. Dieu y maudit deux éléments : le serpent, et le sol. Ni Adam ni Eve ne font l’objet d’une punition. Ils évoluent et gagnent en responsabilité. C’est bien la démonstration qu’on ne peut voir dans le travail un obstacle au bonheur que si on le confond avec la situation absurde provoquée par le simple accomplissement de tâches. Le premier est finalement libérateur quand le second s’applique à aliéner l’homme.
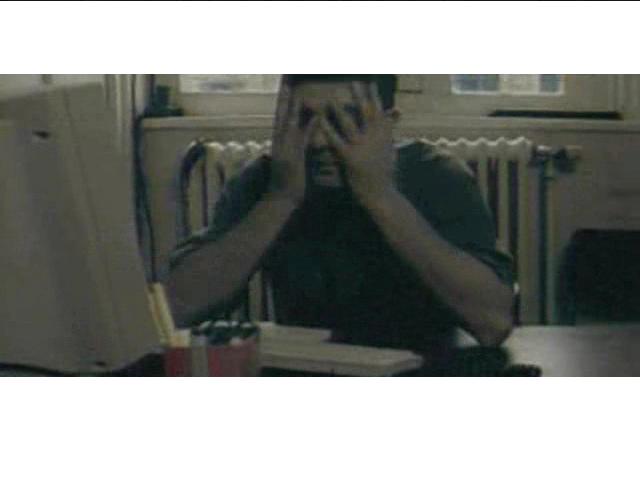
Illustrations toutes extraites du clip de Noir Désir : A l’envers, à l’endroit.
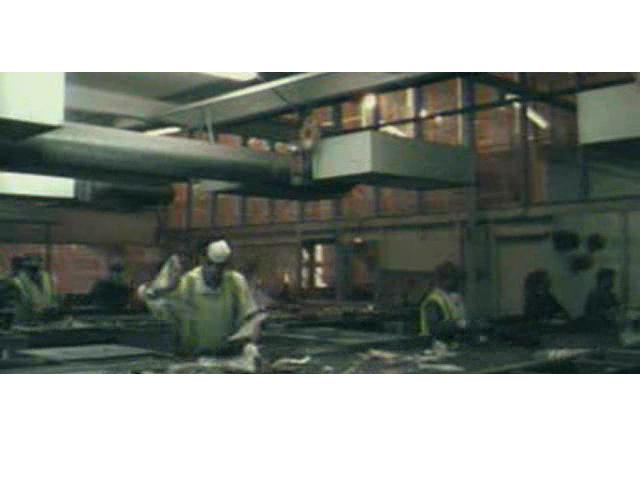
bonjour,
que signifie praxis et poiésis. on peut les ajouter a ce raisonnement ?