Maitres rhéteurs, on devine les philosophes grecs habiles embrouilleurs. Et si la philosophie se donne comme mission la recherche de la vérité, son premier moment, la prise de conscience de l’ignorance dans laquelle nous sommes, peut être considéré comme une illumination si on en fait une ouverture vers une connaissance à découvrir, ou comme une brusque extinction de toutes les lumières s’il s’agit juste de faire perdre le nord à tout le monde en recourant à ces caractéristiques nécessairement ambiguës et arbitraires du discours, telles que les sceptiques les avaient mises à jour.
Ainsi, il y a au moins deux façons de s’affirmer comme sceptique : l’une consiste à prendre cette position au sérieux (ce qui n’interdit pas de le faire avec une certaine joie, comme Montaigne en fait l’exemple). L’autre prend la forme d’un jeu 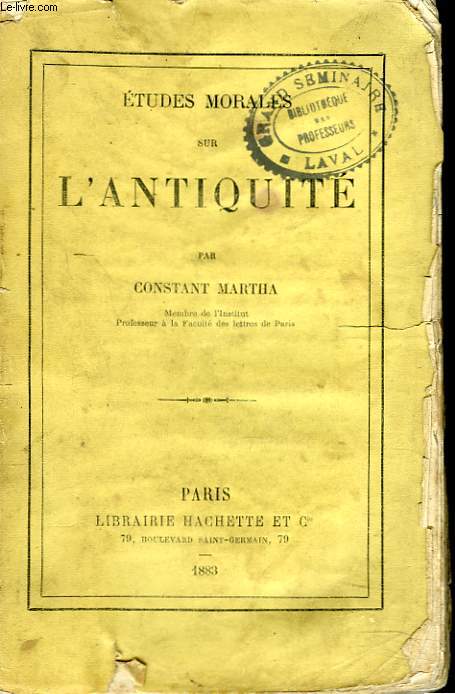 auquel on se livre pour faire la preuve de sa dextérité dans l’art de brouiller les cartes de la réflexion. On peut juger cette manière de faire un peu légère, mais si on prend le scepticisme au sérieux, et qu’on entérine l’abandon de la prétention à la vérité, alors le jeu du langage devient une option assez cohérente, puisqu’on ne peut plus décemment prendre sa propre parole au sérieux. Mieux vaut alors la mettre en scène en braquant la lumière sur le potentiel de contradiction qui sommeille en tout jugement.
auquel on se livre pour faire la preuve de sa dextérité dans l’art de brouiller les cartes de la réflexion. On peut juger cette manière de faire un peu légère, mais si on prend le scepticisme au sérieux, et qu’on entérine l’abandon de la prétention à la vérité, alors le jeu du langage devient une option assez cohérente, puisqu’on ne peut plus décemment prendre sa propre parole au sérieux. Mieux vaut alors la mettre en scène en braquant la lumière sur le potentiel de contradiction qui sommeille en tout jugement.
C’est à ce jeu curieux que se livrèrent une poignée de philosophes grecs envoyés en avocats d’Athènes auprès des autorités romaines, afin d’annuler une amende considérable dont Athènes avait écopé à cause de la mise à sac de la ville d’Orope. Trois fines fleurs de la parole, trois champions issus des trois meilleures écoles de pensée de ce temps là : Critolaüs le péripatéticien, Carnéade l’académicien, et Diogène le Stoïcien. Bien qu’adversaires du point de vue philosophique, ils formeront, pour une fois, équipe, afin d’obtenir une remise de peine pour Athènes, ruinée et incapable de payer l’amende à laquelle Rome l’avait condamnée. Jouant aux plus fins dans une cité Romaine accordant à l’action un fort ascendant sur la parole, ils savaient qu’ils allaient jeter un voile de confusion sur les pensées, et séduire les plus jeunes des citoyens romains, qui verraient là une ouverture d’esprit à laquelle ils n’étaient pas habitués.
L’épisode est très bien reconstitué dans l’ouvrage de Constant Martha, les Etudes morales sur l’Antiquité (1883), au cours d’un chapitre qu’il consacre aux difficultés qu’eut la philosophie à être acceptée à Rome, intitulé Carnéade à Rome. L’ouvrage se trouve assez difficilement en bibliothèque (il est pourtant passionnant). On peut cependant en trouver une édition numérique assez correcte à cette adresse : http://www.mediterranee-antique.info/00Pdf/Martha/Etudes_morales.pdf. On y trouve cet épisode décrit et contextualisé de façon captivante, et éclairante (p. 25 et suivantes).
Mais on peut aussi se reporter aux sources antiques, puisqu’elles nous procurent des témoignages précieux sur les aventures rhétoriques de nos trois philosophes grecs partis arnaquer Rome avec les mots pour seules armes. Constant Martha cite d’ailleurs abondamment ces sources précieuses. Ainsi, nous voyons dans les écrits de Plutarque et d’Aulus Gellius, les trois mercenaires armés de leur seule parole, venir semer une certaine zizanie dans les esprits, avant d’être priés de retourner sur leurs terres, et de laisser les pensées autochtones en paix. L’anecdote est plaisante, mais elle vaut plus que pour le pittoresque de la situation : elle illustre ce que l’amorce du désordre a de dangereux quand il s’agit juste d’opposer toutes les thèses à leur contraire et à installer durablement l’idée selon laquelle finalement, tous les discours se valent, ce qui revient à dire qu’aucun n’a de valeur. Mais ce serait réducteur de n’y voir qu’une fantaisie : le scepticisme a la particularité de ne pouvoir être pleinement adopté en tant que doctrine, tout en s’appuyant sur des arguments qui, une fois rencontrés, ne peuvent être réfutés. Une fois installé, le scepticisme envahit la pensée sans qu’on puisse en limiter l’emprise.
Les deux passages qui suivent ont simplement été retrouvés à partir des notes de bas de page de l’ouvrage essentiel de Victor Brochard, les Sceptiques grecs, p. 125
Tout d’abord, Plutarque, historien romain du premier siècle après JC. La section de ses Vies des hommes illustres consacrée à Caton l’Ancien mentionne l’anecdote atour de laquelle nous tournons. On y cerne assez bien le désordre que l’usage de la parole est capable de semer, la séduction que la destruction des certitudes exerce sur ceux qui, jusque là, n’ont connu qu’une doctrine univoque :
« Caton était déjà vieux lorsque des ambassadeurs d’Athènes, Carnéade, philosophe de l’Académie, et Diogène, philosophe stoïcien, vinrent à Rome solliciter l’annulation d’un jugement porté contre le peuple athénien : poursuivis par les gens d’Oropos, les Athéniens avaient fait défaut et les Sicyoniens les avaient condamnés à une amende de cinq cents talents. Aussitôt les jeunes gens les plus lettrés accoururent auprès de ces personnages et écoutèrent leurs leçons avec admiration. Le talent de Carnéade surtout – talent d’une très grande force et dont la renommée égalait la puissance – lui attira des foules d’auditeurs avides de l’entendre ; ce fut comme un vent impétueux dont le bruit remplit la ville. On disait partout qu’un Grec d’un savoir merveilleux, ensorcelant et subjuguant tous les esprits, inspirait aux jeunes gens une violente passion qui les faisait renoncer à tous les plaisirs et à toute espèce d’occupations dans leur enthousiasme pour la philosophie. La plupart des Romains les approuvaient et voyaient avec plaisir les jeunes gens s’appliquer à la culture grecque et suivre les leçons de ces hommes si admirés ; mais dès le début, aussitôt que ce goût des discussions philosophiques s’instaura dans la ville, Caton s’en alarma : il craignait de voir les jeunes gens, qui tournaient de ce côté leurs ambitions, préférer la gloire de la parole à celle des actions et des armes. Aussi, comme la réputation des philosophes s’accroissait dans la ville et que leurs premiers discours devant le sénat avaient été traduits par un homme illustre, Gaius Acilius, qui avait lui-même réclamé cet honneur avec instance, Caton résolut de débarrasser la ville de tous ces philosophes sous un prétexte honorable. Il se rendit au sénat et reprocha aux magistrats de retenir si longtemps sans résultat une ambassade composée d’hommes capables de persuader aisément tout ce qu’ils voulaient ; il fallait donc, dit-il, prendre une décision au plus vite et voter sur leurs propositions, afin de leur permettre de retourner à leurs écoles pour y discuter avec les enfants des Grecs, tandis que les jeunes Romains écouteraient comme auparavant les lois et les magistrats. »
Plutarque, Vie de Caton l’Ancien, 22
Auteur un peu postérieur à Plutarque, Aulu-Gelle (Aulius Gellius, dans sa langue natale) était un grammairien et compilateur romain du IIè siècle après JC. Dans l’extrait de ses Nuits attiques qui suit, on voit que l’intérêt se porte plus sur la nature et le style du discours des philosophes athéniens que sur l’anecdote elle-même. On perçoit nettement dans ce texte que ces penseurs constituent une référence à laquelle on peut venir se ressourcer. La fin de l’extrait exprime la crainte que ces styles soient employés de façon artificielle, sans vie. On peut en effet reconnaître dans les méthodes de questionnement et d’argumentation sceptiques un genre oratoire spectaculaire qui perd pourtant son sens s’il n’est plus qu’un phénomène de foire. Il y a une frontière finalement assez mince entre le philosophe véritable et l’as du stand up, et à oublier cette fine démarcation, on peut facilement se contenter de faire le malin, séduire rapidement un auditoire avide de ce genre de moments, mais avoir perdu, aussi, tout ce qui fait la beauté de cette pensée :
« XIV. Des trois genres de style et des trois philosophes que les Athéniens envoyèrent en ambassade à Rome.
Dans la poésie comme dans la prose, on admet trois genres de style, χαρακτῆρες, formes, selon les Grecs, qui les désignent des trois noms ἀδρος, abondant, ἰσχνός, simple, μέσος, tempéré. Nous traduisons le premier par uber, riche, le second par gracilis, simple, le troisième par mediocris, tempéré. Le style riche se distingue par la dignité et la grandeur ; le simple, par la grâce et la finesse ; le tempéré tient le milieu entre les deux autres et participe de leurs qualités. Mais à chacune de ces beautés qui caractérisent les trois genres de style correspondent des défauts égaux en nombre, et qui se parent de leur extérieur par une ressemblance mensongère. Ainsi, fort souvent, on prend l’exagération et l’enflure pour la richesse ; l’aridité, la sécheresse pour la simplicité, l’incohérence d’un style sans caractère pour la sobriété dans le langage. M. Varron dit que la langue latine offre trois modèles parfaits de chacun de ces genres : Pacuvius pour le style riche, Lucilius pour le simple, Térence pour le tempéré. Mais des exemples de ces trois genres d’éloquence avaient été donnés, bien des siècles auparavant, par Homère, dans trois de ses personnages : le style d’Ulysse est magnifique et fécond, celui de Ménélas se distingue par la finesse et la retenue, celui de Nestor réunit la richesse du premier et la simplicité du second. On remarqua cette même variété des trois formes de style dans les discours des trois philosophes que les Athéniens envoyèrent au sénat et au peuple romain, pour demander la remise de l’amende à laquelle cette ville avait été condamnée pour la dévastation d’Orope ; l’amende était d’environ cinq cents talents. Ces philosophes étaient Carnéade de l’Académie, Diogène le stoïcien, Critolaos le péripatéticien. Lorsqu’ils eurent été introduits dans la Curie, C. Acilius, l’un des sénateurs, leur servit d’interprète. Mais auparavant chacun d’eux, désirant faire parade de ses talents, avait disserté séparément, en présence d’un concours nombreux d’auditeurs. Rutilius et Polybe rapportent qu’ils se firent admirer, chacun dans un genre différent : Carnéade était véhément et rapide, Critolaos méthodique et simple, Diogène élégant et plein de sobriété. Chacun de ces genres, comme nous l’avons dit, si l’art y est accompagné de pureté et du naturel, peut offrir de grandes beautés ; mais s’il est fardé et apprêté, ce n’est plus alors qu’un exercice frivole fait pour éblouir un moment. »
Aulu-Gelle, Nuits attiques, Livre 7 (que V. Brochard répertorie comme le Livre 6, ce qu’on fait parfois).