Le cours de philosophie, en début d’année de terminale, peut parfois donner l’impression d’être à la frontière du cours d’histoire tant le flash-back vers la Grèce antique y est fréquent. On pourrait se demander pourquoi ce regard constant vers l’arrière, pourquoi cette façon de marcher à reculons, comme s’il ne fallait aller de l’avant que dans la mesure où se garderait bien de 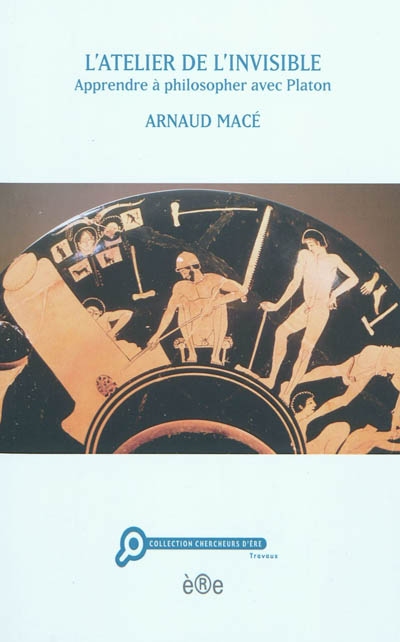 regarder l’horizon devant soi. De deux choses l’une : ou bien cette démarche empêche de marcher, ou bien il y a là, des siècles avant nous-mêmes, quelque chose de ce qu’on cherche. Et on comprend mieux alors ce que la philosophie contient de nostalgie, si elle est bien un mouvement vers ce qui a été perdu, tant et si bien qu’on n’en a même plus l’image et que n’en reste que le manque. « Ceci est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance », ce sont les mots qui introduisent le « photo-roman » de Chris Marker intitulé La Jetée. « Ceci est l’histoire d’une humanité marquée par une image d’enfance », ce pourraient être les mots qui introduiraient à une histoire de la philosophie. On reviendra bientôt sur Chris Marker, promis.
regarder l’horizon devant soi. De deux choses l’une : ou bien cette démarche empêche de marcher, ou bien il y a là, des siècles avant nous-mêmes, quelque chose de ce qu’on cherche. Et on comprend mieux alors ce que la philosophie contient de nostalgie, si elle est bien un mouvement vers ce qui a été perdu, tant et si bien qu’on n’en a même plus l’image et que n’en reste que le manque. « Ceci est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance », ce sont les mots qui introduisent le « photo-roman » de Chris Marker intitulé La Jetée. « Ceci est l’histoire d’une humanité marquée par une image d’enfance », ce pourraient être les mots qui introduiraient à une histoire de la philosophie. On reviendra bientôt sur Chris Marker, promis.
Mais nous avons pris l’habitude de penser que ce vers quoi nous nous tournons relève d’une rupture. Arrachement d’avec le quotidien, élévation au dessus des apparences, nous sommes facilement convaincus que ce que les Grecs ont apporté et dont nous serions les héritiers relève d’un divorce permis par le logos, qui aurait séparé les hommes en deux catégories : ceux qui sont voués au labeur, à la peine, qui travaillent de leurs dix doigts, et ceux qui pensent, libérés des tâches du quotidien par les efforts de ceux-là mêmes qui y sont voués. C’est oublier comment les Grecs, quand ils philosophent, reviennent sans cesses aux expériences sensibles pour parvenir à faire apparaître les concepts. Si Platon fait à ce point intervenir le mythe dans l’expression de sa pensée, c’est parce que ces récits sont « justes », et que sur les sujets qui préoccupent la philosophie, le « juste » est peut être ce qui s’approche le plus du « vrai ». Aristote lui même, qui pourtant abandonnera dans ses ouvrages le recours aux mythes, écrira pourtant que ceux ci ont quelque chose de merveilleux qui est à la racine de l’étonnement sans lequel la philosophie ne peut pas naître.
C’est que le logos qui préside à la pensée quand elle devient philosophie n’est pas une rupture avec un ordre qui l’aurait précédé, et dont il serait le contre-pied. C’est plutôt le même mouvement, effectué avec davantage de conscience, et plus profondément, c’est aussi une synthèse entre les préoccupations auxquelles les mythes donnaient réponse sans même qu’il soit nécessaire de poser les questions, et l’attachement à la matière dont firent preuve les tout premiers physiciens : philosopher, ce serait appliquer l’ordre du logos à des questions qui ne relèvent pas de la matière. Ainsi, le philosophe peut-il trouver dans ses prédécesseurs, les conteurs, les bricoleurs de la matière, les Géo-Trouvetou, non pas des ancêtres dont il aurait quelque raison d’avoir honte, une généalogie dont il devrait s’amputer, mais des frères avec lesquels, en contemporain, il pourrait dialoguer. Il y a donc déjà quelque chose de la philosophie dans ce qui n’est pas encore philosophie, et si on pouvait saisir ce quelque chose, on dirait que ce serait son objet. A défaut, ce sera l’image perdue de cet objet. Il y a alors quelque chose de l’objet de la philosophie dans l’artisanat, même si c’est sous la forme d’une image dans laquelle on peine tant à reconnaître cet objet qu’on aurait tendance à s’en détourner. Après tout, qu’est ce qu’un artisan si ce n’est quelqu’un qui sait faire ce dont il ne sait pas comment ça se fait, et comment ça se fait qu’il sache le faire ? Qu’est ce qu’un artisan si ce n’est un homme qui oeuvre en direction d’une forme dont il ne sait ce qu’elle est qu’une fois qu’il l’a achevée ?
On comprend alors les raisons pour lesquelles Arnaud Macé, lorsqu’il écrit cette belle introduction à la philosophie qu’est L’atelier de l’invisible – Apprendre à philosopher avec Platon, s’intéresse tout particulièrement à toute cette main d’oeuvre qu’on croise dans les dialogues de Platon, aux côtés de Socrate, dont on ne peut pas remarquer qu’il fait, avec les concepts, ce qu’un potier fait avec la terre glaise. Il y a chez Socrate aussi un savoir-faire dont lui-même semble ne pas savoir d’où ça vient qu’il le maîtrise, une présence en lui d’un savoir qui sait y faire et lui permet de faire, comme le fait l’amant après l’amour, de beaux discours. Et ce serait là que se situerait tout l’intérêt du retour vers les Grecs, qui ne se limiterait pas à à une idolâtrie de Socrate en personne, mais remonterait à ceux qui le côtoyaient, et alimentaient ses propres discours.
Pour donner une idée de l’intérêt de cet ouvrage, je reproduis ci dessous quelques lignes de son prologue, intitulées Pourquoi les Grecs ? J’en reproduis y compris la note de bas de page, parce qu’au delà du recours captivant au détails des dialogues de Platon, ce livre vaut aussi pour les multiples références qu’il propose, qui sont autant de portes ouvertes vers de nouvelles lectures. Normalement, tout à l’heure, quand vous aurez atteint la fin de cet article, vous serez déjà en train de chercher à mettre la main sur un volume d’occasion du livre de Norman Austin, Archery at the dark of the moon : poetic problems in Homer’s Odyssey.
« Pourquoi faut-il que nous allions si loin dans le temps ? Peut-être que notre apprentissage suppose t-il plus qu’un voyage dans l’espace : le temps nous ouvre aussi l’exploration d’une multiplicité de choses à visiter, d’autant plus intéressantes, peut-être, qu’elles viennent de loin. Or les anciens Grecs viennent de loin. Ils sont certes des membres de la même espèce, mais aussi, en un sens, ils sont déjà une autre humanité, dotée d’une pensée, de mœurs et de sentiments qui ne sont plus les nôtres : ils sont un monde englouti dont nous déchiffrons les bribes. Et pourtant cette civilisation disparue nous regarde encore : les anciens Grecs sont peut être ce qu’il y a de plus proche dans ce qui est déjà lointain, ce avec quoi, parmi les autres formes de vie humaine, nous partageons encore suffisamment de mots et de pratiques pour que la considération de ce qu’il nous reste de commun, par-delà la distance et les variations, nous renvoie de nous-mêmes une image venue d’un autre monde. Ce sont des aborigènes qui nous parlent des pratiques que nous tenons pour être le fleuron de notre culture : la science, les arts, l’organisation de l’Etat. Ils projettent l’ombre d’une soudaine altérité sur ce qui nous semble nous constituer si intimement. A nous regarder en eux, c’est à nous-mêmes que nous paraissons appartenir un peu moins chaque jour.
Or cette humanité si lointaine nous dit déjà qu’il faut philosopher. C’est à dire aimer le savoir, tous les savoirs. Les anciens Grecs les aimèrent sous toutes leurs formes, à commencer par celles sous lesquelles ils se présentent dans la vie la plus quotidienne. Homère, en racontant les aventures d’Ulysse, est toujours attentif aux œuvres de l’esprit humain : construire un bateau, naviguer aux étoiles, accomplir un sacrifice, faire du bois un meuble, de la laine un vêtement. C’est partout « l’éloge du professionnalisme » qui est fait par le poète : qu’il chante, soigne, dise l’avenir ou fasse des charpentes, l’artisan est constamment loué pour ses performances, et son savoir-faire l’expose individuellement à l’admiration et le propose à la mémoire*. Le charpentier, le médecin, ou l’aède qui chante de village en village : voilà autant de gens que les Grecs appelaient des « démiourgoï« , c’est à dire des gens qui travaillent pour la communauté, qui rendent un service au public et qui son, pour cette raison, toujours bienvenus partout où ils vont, comme il est dit dans l’Odyssée (17, 383). Les Grecs ont perçu le savoir, tel qu’il se présentait sous la figure du charpentier ou du médecin, comme un « bien commun » (xunon agathon) », pour reprendre l’expression même d’Hippocrate, le médecin grec, s’il est bien l’auteur du traité intitulé Les Vents (I.1-21). Le savoir donne corps à la collectivité en faisant exister un bien qui appartient en propre à celle-ci : un service public.
Quoi d’étonnant dès lors à ce que l’ouvrage des gens de métier soit devenu pour les Grecs une référence commune ? Quoi d’étonnant à ce qu’Homère, lorsqu’il veut nous faire voir le nuage de poussière au-dessus du choc des armes sur le champ de bataille, nous demande d’imaginer un groupe de paysans en train de battre le blé avec des vans, de voir l’écorce du grain qui volète au-dessus de leurs têtes (Illiade V 494-506) ? Quoi d’étonnant, lorsqu’il veut nous faire sentir la force de la parole d’Achille parlant à ses troupe, qu’il nous demande d’imaginer le moment où, sous les coups du charpentier, les pièces de bois se resserrent les unes contre les autres, comme les soldats resserrent leurs rangs à l’écoute de leur chef (Illiade XVI 210-217) ? Le savoir-faire à l’oeuvre n’est pas seulement un bien commun, c’est aussi un langage commun : une source d’analogies permettant aux Grecs de partager les expériences les plus diverses, de les rendre palpables, visibles au plus grand nombre. Voilà donc le miroir que nous tendent encore les Grecs. Ils nous demandent ce que nous avons fait de leur amour des savoirs, de l’idée d’un bien public et d’un langage commun dont cet amour était le pilier. Qu’avons nous fait de l’étrange idée que cette disposition à connaître et à savoir faire, qui nous met en contact avec la structure même des choses, est une expérience qui modifie profondément le vivant que nous sommes, en développant sa capacité à construire le monde commun d’une vie collective heureuse et à trouver sa juste place au sein des choses ?
*Nous citons et paraphrasons Norman Austin, Archery at the dark of the moon : poetic problems in Homer’s Odyssey, Berkeley, 1982, University of California Press, p. 179″
Arnaud Macé, L’atelier de l’invisible – Apprendre à philosopher avec Platon, 2010, Ed. ère, p. 6-7