Avant tout autre abord, peut-être est-il préférable pour apprécier à leur juste valeur les oeuvres d’art, de discerner ce qu’elles sont, au-delà de ce qu’elles peuvent sembler représenter. Car on peut légitimement penser que le coeur de l’oeuvre se trouve moins dans ce qu’elles représente, que dans sont aptitude à constituer, par elle-même, une présentation, une présence qui se suffit à elle-même.
On se souvient sans doute de la manière dont Malraux traçait les lignes directrices de quelques arts dans les Voix du silence :
« De même qu’un musicien aime la musique et non les rossignols, un poète les vers et non les couchers de soleil, un peintre n’est pas d’abord un homme qui aime les figures et les paysages: c’est d’abord un homme qui aime les tableaux. »
Mais on ne peut s’empêcher de lire ces propos en se demandant si on pourrait réitérer le même exercice pour tous les autres arts. Si on devine assez bien ce que ça peut donner pour la sculpture ou la littérature, on peut se demander si la formule pourrait s’appliquer au cinéma. Au premier abord, ça semble fonctionner : on définirait alors Quentin Tarantino comme cinéaste ultime,  dans la mesure où lui-même confesse passer le plus clair de son temps à regarder les films des autres, constituant ses propres oeuvres commme des dialogues avec des films dont il est l’ambassadeur et le transmetteur. On mesurerait alors ici la part de la culture et de l’érudition dans la constitution d’une oeuvre. A l’opposé d’un Dubuffet plaidant en faveur d’un art brut détaché de toute histoire et de toute culture officielle, Malraux considérerait qu’être cinéaste, ce serait avant tout s’y connaître en histoire du cinéma.
dans la mesure où lui-même confesse passer le plus clair de son temps à regarder les films des autres, constituant ses propres oeuvres commme des dialogues avec des films dont il est l’ambassadeur et le transmetteur. On mesurerait alors ici la part de la culture et de l’érudition dans la constitution d’une oeuvre. A l’opposé d’un Dubuffet plaidant en faveur d’un art brut détaché de toute histoire et de toute culture officielle, Malraux considérerait qu’être cinéaste, ce serait avant tout s’y connaître en histoire du cinéma.
Mais affirmer que le cinéma se définit par l’intérêt que portent les réalisateurs pour leur propre art, voila qui ne définit cependant pas ce qu’est, à l’origine, le septième art. Aussi faudrait-il se tourner vers d’autres auteurs pour en percevoir l’essence. Deleuze, qui y voit un travail sur la matière qu’est le temps (après tout, un film, c’est avant tout une question d’accélération, ralentis, flash-backs, flash-forvards, temps réel, plans séquences), ou bien vers Alain Badiou, qui dans le texte qui suit, propose une autre voie, plus abstraite, mais touchant pourtant à des expériences précises que les amateurs de salles obscures auront peut être déjà ressenties.
Parce que ce texte est très proche de ce qu’on a déjà pu évoquer en cours, parce qu’il exprime plus complètement, et plus conceptuellement ces ébauches évoquées dans diverses séquences de cours, je tenais à partager ici cette récente découverte. Après tout, les auteurs servent aussi à exprimer à notre place les intuitions qui nous animent, et à leur donner corps :
« Le sujet d’un film n’est pas son histoire, son intrigue, mais ce sur quoi ce film prend position, et par quelle forme cinématographique il le fait. C’est depuis ce lieu précis, celui de l’agencement artistique, que le film affirme son sujet. On peut donc en penser que c’est cela qui va rester dans l’esprit du spectateur, même parfois sans qu’il le sache […] Un film est une proposition en pensée, est un mouvement de la pensée, une pensée comme articulée à sa disposition artistique. Comment cette pensée existe et passe-t-elle ? Elle est transmise à travers l’expérience de la vision du film, dans son mouvement : ce n’est pas ce que dit le film, ce n’est pas l’agencement de l’intrigue qui comptent, c’est le mouvement même qui transmet la pensée du film. Son identification est certes complexe, car un film, tout film, est une association qui fait, refait le monde selon une complexité inouïe, d’autant plus qu’un grand nombre de paramètres ne sont pas contrôlés : le cinéaste compte beaucoup sur les hasards, qu’il aime inviter sur un tournage par exemple. La vérité que produit le cinéma est marquée par tout cela , elle est transmise en bloc dans son mouvement et sa restitution.
Alain Badiou, entretien avec Antoine de Baecque dans « Cinéma«
Sans doute faut-il préciser quelques éléments pour mieux saisir ces quelques lignes. Tout d’abord, bien que Badiou soit notre contemporain, il ne fait pas partie de ceux qui ont abandonné le concept de vérité, même s’il considère celle-ci comme multiple. Il pense que divers régimes de la pensée et de l’activité humaines produisent divers types de vérités. Ces régimes de production de la vérité (il faudrait concevoir ici le mot régime à mi-chemin du sens qu’on lui donne quand on parle de « régime politique » et de « régime moteur »), il en distingue quatre : la science, l’action politique, l’art, et l’amour. On pourrait être étonné de ne pas voir mentionner ici la philosophie. Mais il ne faut pas s’en chagriner : pour Badiou, la philosophie ne produit pas de vérité. Elle a pour tâcher de saisir les vérités dans les divers régimes qui les produisent, afin de les mettre à jour, de les partager et de les faire dialoguer.
De tous les arts, le cinéma est peut-être celui qui se présente le moins comme tel, comme si son activité centrale consistait à effacer en lui son appartenance au domaine artistique, ce qui fait de lui en même temps le plus impur de tous les arts (on peut facilement le considérer comme une simple activité de représentation du réel, ou de fantasme, mais en même temps, au moins, on ne risque pas d’en faire une idole, puisque plus que les autres, il semble être un art compromis avec le réel.
D’une certaine façon, le cinéma est intimement mêlé avec la quête philosophique : chez Badiou, la question de la vérité fait l’objet d’une quête qui se déploie quelque part entre la nostalgie (l’hommage qu’il rend, dernièrement, à Platon, à sa République et à l’épisode de la Caverne, permet de le saisir) et ce qui est à venir. Or, au cinéma, c’est précisément de cette double 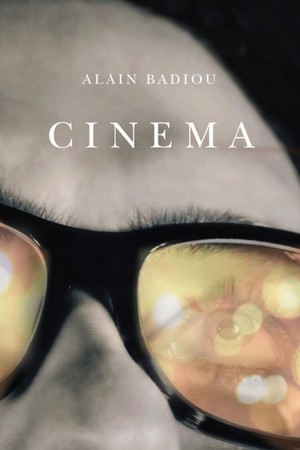 dimension qu’il s’agit : le cinéma a toujours été un art de la nostalgie, saisissant un mouvement qui ne peut être qu’une fois, et le reproduisant pourtant, saisissant tout particulièrement des vies déjà achevées, projetant l’image de morts, vivants. C’est ainsi que nait le fantascope, l’ancêtre du cinéma. Qu’on regarde attentivement La Jetée, de Chris Marker, et on saisira au sein des images fixes (mais le repos n’est qu’un cas particulier du mouvement) ce qu’est, dans le fond, le cinéma. Double dimension car le cinéma est aussi le moyen technique d’un mouvement qu’on peut reproduire pour peu qu’on dispose d’un projecteur et d’une surface pour y produire le miracle de l’image qui met du mouvement dans la tête. Par définition, le cinéma est une utopie, dans la mesure où son être ne peut être situé nulle part. Il est plutôt de l’ordre de la tension. De l’attention. Tout comme la conscience en somme. A le concevoir ainsi comme « un pont jeté entre le passé et l’avenir« , on en viendrait presque à voir en lui la forme même de la conscience.
dimension qu’il s’agit : le cinéma a toujours été un art de la nostalgie, saisissant un mouvement qui ne peut être qu’une fois, et le reproduisant pourtant, saisissant tout particulièrement des vies déjà achevées, projetant l’image de morts, vivants. C’est ainsi que nait le fantascope, l’ancêtre du cinéma. Qu’on regarde attentivement La Jetée, de Chris Marker, et on saisira au sein des images fixes (mais le repos n’est qu’un cas particulier du mouvement) ce qu’est, dans le fond, le cinéma. Double dimension car le cinéma est aussi le moyen technique d’un mouvement qu’on peut reproduire pour peu qu’on dispose d’un projecteur et d’une surface pour y produire le miracle de l’image qui met du mouvement dans la tête. Par définition, le cinéma est une utopie, dans la mesure où son être ne peut être situé nulle part. Il est plutôt de l’ordre de la tension. De l’attention. Tout comme la conscience en somme. A le concevoir ainsi comme « un pont jeté entre le passé et l’avenir« , on en viendrait presque à voir en lui la forme même de la conscience.
Philosopher, c’est peut-être se rendre peu à peu compte de la propension qu’a la réalité à nous être intérieure (et peut-être aussi à constater à quel point on se trouve au contraire au-delà de soi-même). A strictement parler, la réalité est l’objet d’une réalisation. Ce n’est peut être pas tout à fait un hasard du vocabulaire s’il en va de même d’un film. En méditant suffisamment, on devrait pouvoir intégrer cette phrase, centrale dans l’extrait que je partage ici : « un film, tout film, est une association qui fait, refait le monde ». C’est aussi une définition de la pensée.