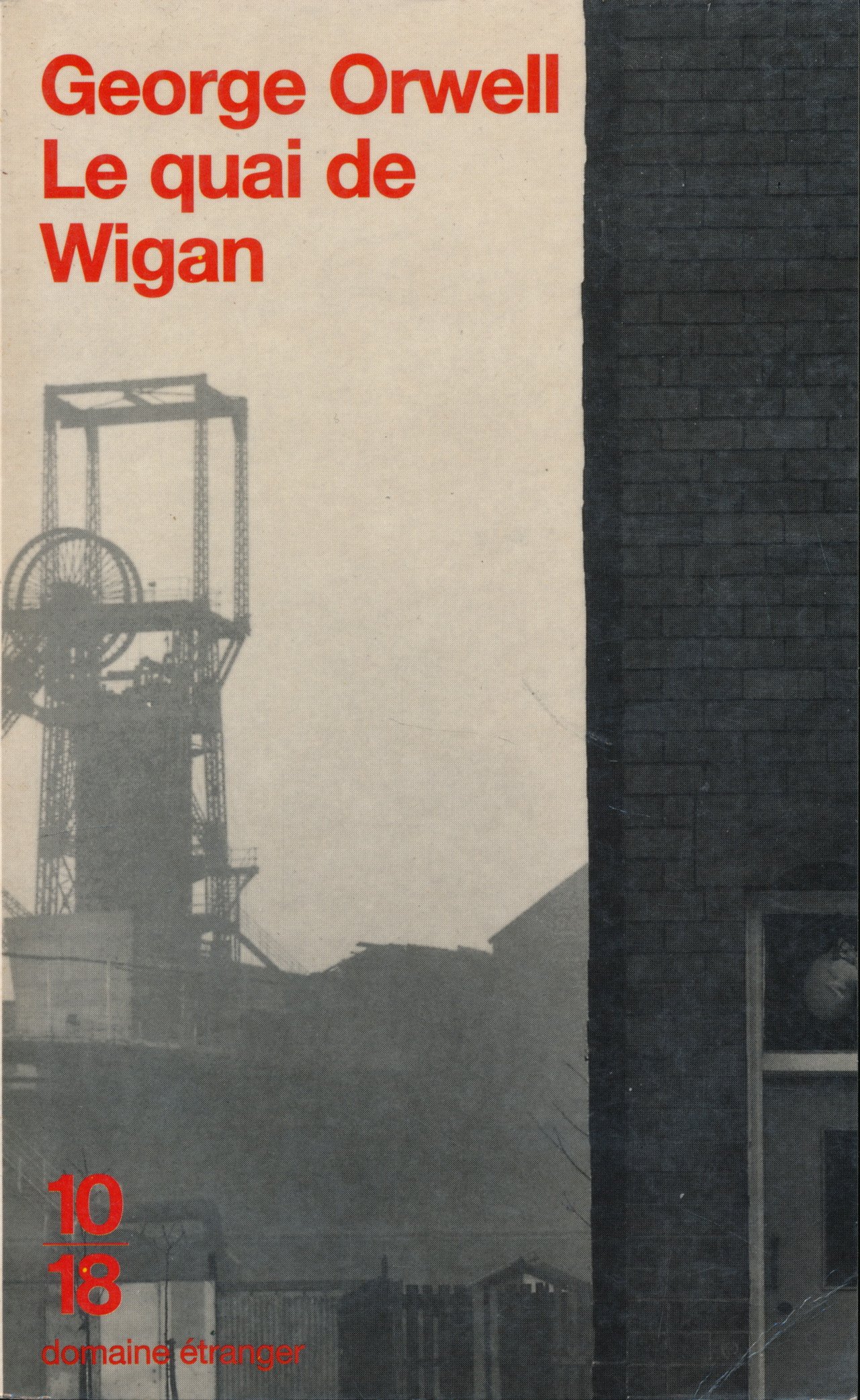On revient un peu sur les temps étranges que nous traversons ?
Et si, en fait, ils n’étaient pas si étranges que ça ? Et si finalement, ce sont les temps qui ont précédé qui resteront dans l’histoire comme étranges, problématiques ? Et si finalement ce à quoi nous assistons, ce n’était rien d’autre que le retour du banal, du commun, de ce qui aurait dû aller de soi depuis longtemps ?
Cela ne nous pendait-il pas au nez ?
On l’a déjà évoqué, parmi les auteurs qui se sont, profondément, intéressés à la vie commune (qui est tout autant la vie banale de ceux qui vivent la même vie que les autres, dans les mêmes logements, au même boulot, avec les mêmes occupations, les mêmes mots pour dire les choses, les mêmes coutumes, que la vie partagée avec les autres), on trouve George Orwell. Si ce motif n’est pas manifestement visible dans son fameux 1984, quoiqu’il s’y intéresse de très près à la vie quotidienne des personnages dont il suit le sort, et quoiqu’il propose une peinture de la relation amoureuse éloignée de toute envolée, et ramenée au contraire à ce que les uns et les autres vivent, un peu trivialement, sans qu’il y ait là rien d’extraordinaire, on le trouve en revanche clairement abordé dans ses enquêtes journalistiques. Parmi celles-ci, il y a ce passage qu’un partenaire occasionnel, et précieux, de réflexion m’a envoyé récemment. On trouve ces mots dans une de celles ci, Le Quai de Wigan (The Wigan Pier, en VO), qui prend sa source dans la plongée d’Orwell dans le monde des mineurs du nord de l’Angleterre dans les années trente. Impliqué physiquement dans son enquête, Orwell est néanmoins conscient de s’introduire dans un univers qui n’est pas le sien, qui lui semble dès lors extraordinaire, et même hostile. On a du mal à penser que le monde des autres puisse leur être familier, que leurs usages, leurs coutumes, les objets dont ils se servent, les lieux où ils vivent puissent constituer, simplement, leur quotidien.
Dans les lignes qui suivent, Orwell va faire l’expérience, et la découverte de cette banalité du monde ouvrier, et constater qu’il est beaucoup plus facile qu’on ne pense d’y entrer, précisément parce qu’il ne prétend pas être hors du commun.
« Au commencement ce ne fut pas facile. Il fallait jouer la comédie, et je ne suis pas un bon acteur. Par exemple, je suis incapable de changer mon accent plus de quelques minutes (…). Je me procurai un déguisement approprié et l’enduisis de crasse ci et là (…). Je me mis en route au hasard jusqu’à ce que je rencontrasse un de ces dortoirs populaires (…). C’était un endroit sombre, d’apparence malpropre. Dieu ! ce qu’il m’a fallu de courage pour y entrer – cela me parait stupide maintenant. Mais, voyez-vous, j’étais à moitié terrifié par la classe ouvrière. Je voulais entrer en contact avec les travailleurs, devenir l’un d’eux, mais en même temps je me les figurais comme une espèce étrangère et dangereuse ; franchir la porte sombre de ce dortoir me parut comme de m’enfoncer dans quelque souterrain affreux – un égout plein de rats par exemple. J’étais convaincu que j’allais devoir me battre : les gens allaient certainement détecter que je n’étais pas un des leurs, et déduire aussitôt que j’étais venu les espionner ; ce qui les amènerait à me rosser et à me jeter dehors – c’est à cela que je m’attendais. (…)
A l’intérieur, il y avait des débardeurs, des terrassiers et quelques marins assis çà et là, jouant aux cartes et buvant du thé. Ils me regardèrent à peine. Mais c’était un samedi soir, et il y avait un jeune débardeur bâti en force, qui était ivre et titubait à travers la salle. Il se tourna, m’aperçut, et roula vers moi, avec sa grosse figure rouge en avant et un éclair louche et dangereux dans le regard. Je me raidis. Ça y était donc, la bagarre allait déjà commencer ! La seconde d’après, le débardeur s’effondra contre ma poitrine en m’entourant le cou de ses bras : « Prends une bonne tasse de thé, mon pote, cria-t-il, larmoyant, prends une bonne tasse de thé ! » Je pris une tasse de thé. Ce fut une sorte de baptême »